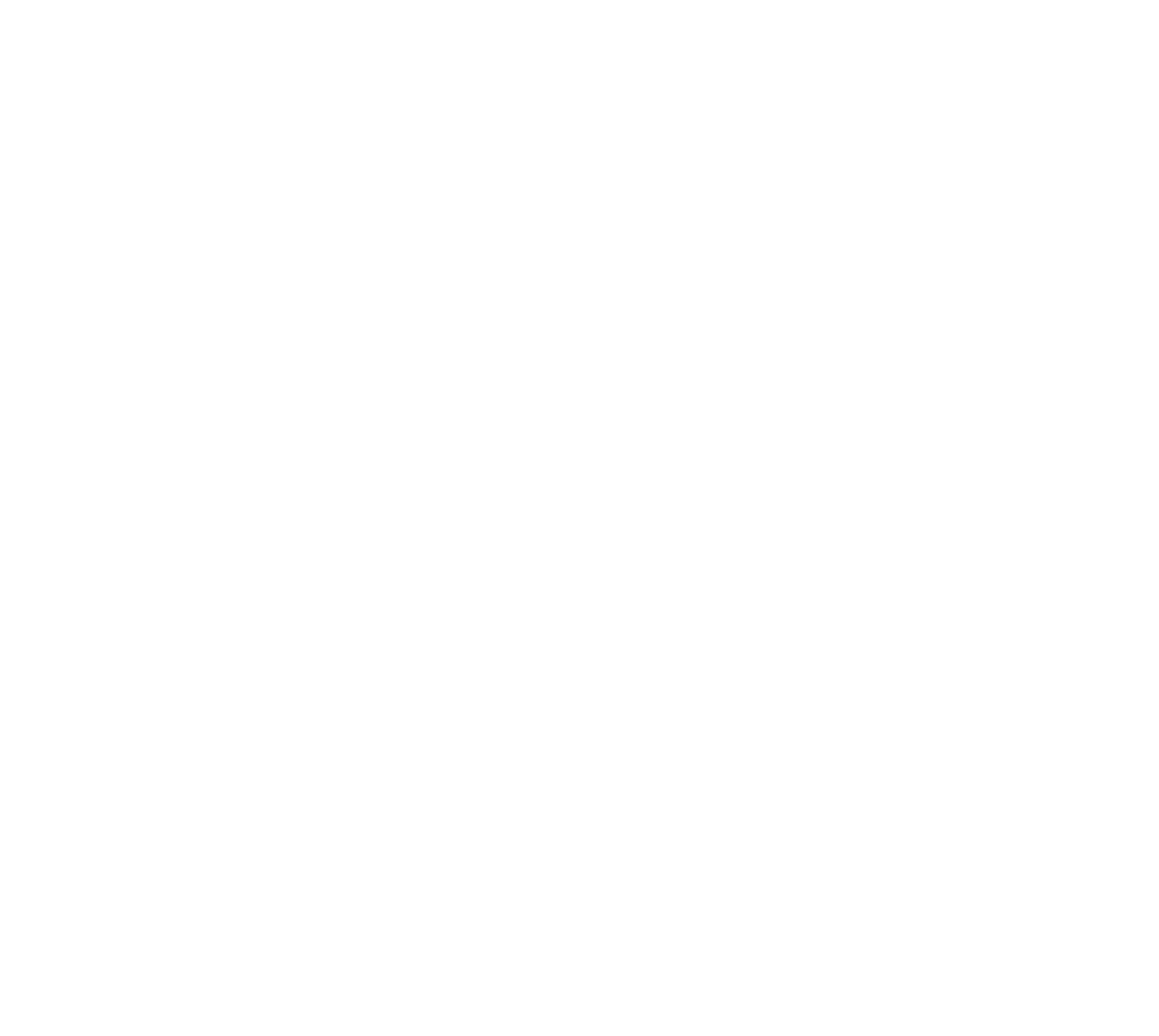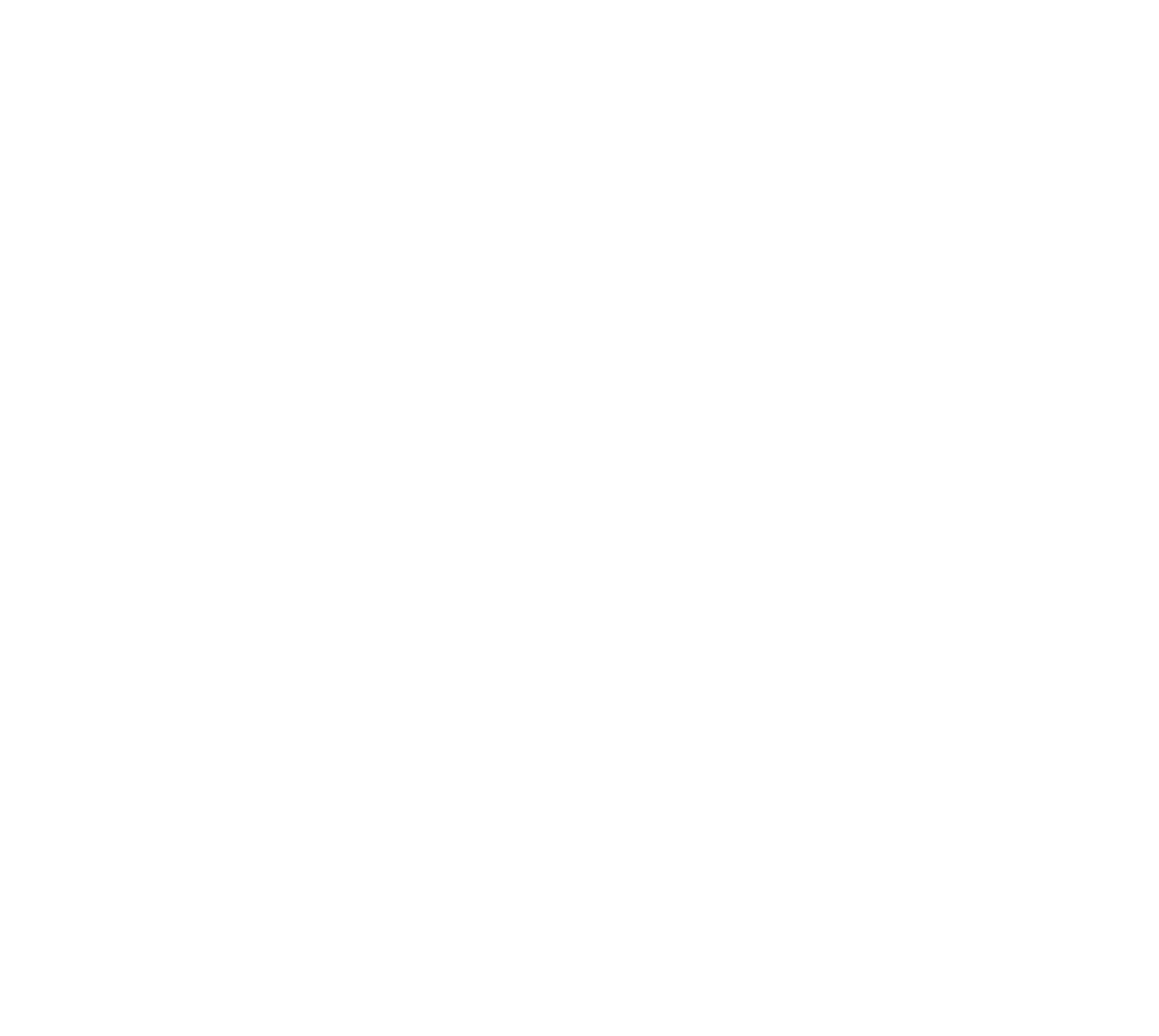Georges Rouget:
Georges Rouget nait le 26 août 1783 à Paris dans un milieu plutôt modeste. Très jeune, il manifeste des aptitudes et un certain goût pour le dessin, il intègre donc dès 1790 l’atelier du peintre Michel Garnier, un ami de la famille. Grâce à ce dernier, il s’inscrit en 1796 à l’Ecole des Beaux-arts, au sein de laquelle il évolue jusqu’en 1799, date présumée de sa rencontre avec Jacques-Louis David. C’est dans la classe de la bosse à l’Ecole que David remarquant son talent, s’arrête derrière le jeune élève afin de le complimenter sur son travail. Il demande alors à Rouget de lui montrer d’autres travaux. Impressionné par le dessin que le jeune garçon lui présente, il rencontre ses parents afin de les convaincre de le pousser dans une carrière artistique et de le laisser intégrer son atelier. Des témoignages de l’époque révèlent l’affection que David portait au petit Rouget qui est rapidement adopté par le cercle de son maitre. De 1803 à 1805, Rouget concoure au prix de Rome, deuxième grand prix en 1803, il ne parviendra néanmoins jamais à décrocher la première place. À compter de 1805, David lui propose de l’aider dans la réalisation de ses œuvres. Plus qu’un simple travail de retouche, il fait de son élève son bras droit, celui-ci étant quelques fois même amené à achever les œuvres commencées par le maitre. Leur étroite collaboration a pour conséquence qu’il est aujourd’hui très difficile de distinguer les deux mains dans certaines réalisations de David. Ce partenariat est reconnu et valorisé par David lui-même qui présente son apprenti, qu’il considère désormais comme son égal, comme son bras droit. Dans le Sacre de Napoléon, dans lequel l’intervention de Rouget est importante, David lui rendra hommage en le faisant apparaitre sur le tableau dans la tribune à ses côtés. Après l’exil de David en Belgique, Rouget qui jouit d’une réputation solidement établie se verra confier de nombreuses commandes officielles sous la restauration et sous la Monarchie de Juillet. De ce fait, plusieurs de ses toiles sont aujourd’hui conservées au sein des collections publiques françaises, nous pouvons citer à ce titre : Œdipe et Antigone sur le mont Cytheron (1814) L’assemblée des notables à Rouen (1822), Saint Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes (1826), Portrait de Clovis III roi d’Austrasie (1836).

Georges ROUGET. 1783-1869.
Autoportrait,
1850,
Huile sur toile, 73,5 x 59,5 cm
Château de Versailles,
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles)

Jacques-Louis DAVID. 1748-1825.
Portrait de l’artiste,
1794,
Huile sur toile, 81 x 105 cm
Musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

George ROUGET. 1783-1869. Artiste peintre.
Buste du berger Pâris. Avant 1818.
Signé par l’artiste
Huile sur panneau
35,7 x 30,8 cm
Cette huile sur panneau représente le berger Pâris, personnage mythique de l’épopée troyenne. À sa naissance un oracle averti son père le roi Priam que Pâris sera la cause de la destruction de sa cité bien-aimée de Troie. L’enfant est alors abandonné sur le mont Ida où il est recueilli et élevé par le berger Agélaos. Devenu adulte, c’est alors qu’il garde des troupeaux, que les trois déesses Athéna, Héra et Aphrodite le choisissent pour les départager dans un concours de beauté dont l’issue mènera à la Guerre de Troie. Dans la légende, Paris grandi en Phrygie, le bonnet phrygien devient donc son emblème et très tôt son iconographie devient indissociable du couvre-chef.

Artiste anonyme allemand.
Tête de Pâris,
Début du XIXème siècle,
Huile sur toile, 73 x 62 cm
Musée de l’Hermitage
© The State Hermitage Museum

Jacques-Louis DAVID. 1748-1825.
Les amours de Pâris et d'Hélène
1788,
Huile sur toile, 146 x 181 cm
Musée du Louvre
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean
Dans ce tableau toute la dextérité de Rouget s’observe, la composition s’harmonise parfaitement grâce à une palette jouant sur des tons de vert plutôt foncé qui permettent de mettre en valeur la fraicheur juvénile des chairs du berger. L’expression du jeune garçon est très savamment étudiée, tout en retenue, il se dégage de son visage qui pourrait sembler neutre au premier abord, une sorte d’inquiétude mêlée à une innocence touchante. Son regard lancé vers un horizon lointain, invisible au spectateur, semble se poser sur une destinée qu’il sait funeste. Dans cette œuvre saisissante, Rouget expérimente à la fois un travail sur la beauté, mais également sur la subtilité des émotions.
Elle provient de la collection d’Athanase Lavallée (1768-1818), secrétaire du musée du Louvre, à l’époque dénommé musée Napoléon, à compter 1797, il sera le bras droit de Vivant Denon et le remplacera même à la tête de l’institution lors de sa démission en 1815. C’est lors d’une vente organisée à sa mort, le 9 mars 1818 que le tableau est adjugé à M. Bouteville pour la somme de 40 francs. L’œuvre est cité par le spécialiste du peintre Mr Alain Pougetoux dans le catalogue de l’exposition dédié à Georges Rouget qui s’est tenu au musée de la Vie romantique en 1995[1].

Attribué à Pierre-Paul PRUD’HON. 1758-1823.
Portrait d’Athanase Lavallée,
1809,
Huile sur toile,
Musée des Beaux-arts d’Orléans
© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
Nous remercions le spécialiste de Georges Rouget, Monsieur Alain Pougetoux pour avoir authentifié notre œuvre.
Quelques œuvres dans les collections publiques :
- Georges ROUGET, Mariage religieux de Napoléon Ier et de l'archiduchesse Marie-Louise, 1810, huile sur toile, 185 x 182 cm, Château de Versailles
- Georges ROUGET, Mesdemoiselles Mollien, 1811, huile sur toile, 130 x 97,3 cm, Musée du Louvre
- Georges ROUGET, Œdipe et Antigone sur le mont Cytheron, 1814, huile sur toile, 276,5 x 212,5 cm, Musée des Beaux-arts de Rouen
- Georges ROUGET, L’assemblée des notables à Rouen, 1822, huile sur toile, 385 x 304 cm, Château de Versailles
- Georges ROUGET, Saint Louis rendant la justice sous un chêne à Vincennes (1826), huile sur toile, 320 x 261 cm, Château de Versailles
- Georges ROUGET, Portrait de Clovis III roi d’Austrasie (1836), huile sur toile, 92,5 x 75 cm, Château de Versailles
[1] Alain Pougetoux, Georges Rouget élève de David, musée de la Vie romantique 12 septembre-17 décembre 1995, Paris musées, 1995, p.138